
Il y a quelques années de cela, on m’a offert cette peinture d’une jeune fille portant un brassard de Garde rouge, hóng wèi bīng 紅衛兵. Il s’agit du portrait supposé de Song Binbin 宋彬彬, qui naquit en 1947 à Pékin. Elle était la fille de Song Renqiong, l’un des fondateurs de l’Armée rouge en 1927. En 1966, Song Binbin est élève dans un lycée de jeunes filles réservé aux enfants de cadres du PC. Elle va, brusquement, passer de l’anonymat à la célébrité en prenant exemple sur une enseignante de l’université Tsinghua de Pékin.
Le 25 mai de cette année-là, donc, une enseignante de cette université pékinoise, qui est également membre du PC, rédige avec quelques collègues du Parti le premier dazibao moderne 大字报, autrement dit un texte écrit à la main et collé sur un mur. Cette affiche appelle les étudiants à se rebeller contre la présidence de l’université, qualifiée de bourgeoise anti-révolutionnaire. C’est ainsi que naissent les premiers Gardes rouges.

Collage de dazibao sur un mur de Pékin en 1966
Le 5 août 1966, Song Binbin, alors âgée de dix-sept ans, publie à son tour un dazibao dans lequel elle condamne les professeurs de son lycée coupables de vouloir restaurer l’ancien ordre bourgeois. Plusieurs lycéennes se rassemblent autour d’elle, forment une unité de Gardes rouges. Et toutes ensemble elles se saisissent de la directrice et du directeur adjoint qu’elles battent avec des bâtons hérissés de clous. Le directeur adjoint parvient à survivre à ce lynchage, la directrice, quant à elle, trépasse. Song Binbin affirmera par la suite qu’elle n’avait pas participé au massacre. Mais elle était présente, et ne l’empêcha pas.
Deux semaines plus tard, le 18 août 1966, des milliers de Gardes rouges, collégiens, lycéens et étudiants, se rassemblent sur la place Tian’anmen à Pékin. Mao Zedong est là, sur la terrasse de la Porte de la Paix céleste et, dans une mise en scène qui deviendra un moment et une photo historiques, Song Binbin lui passe le brassard des Gardes rouges.

En acceptant ce brassard, en donnant à Song Binbin le surnom de Yaowu 要武, Combattante importante, et en prônant la révolte, Mao encourage les Gardes rouges qui deviennent ainsi le bras armé de la toute nouvelle Révolution culturelle.

Song Binbin alias Song Yaowu et Mao Zedong, entourés de Gardes rouges,
le 18 août 1966 sur la place Tian’anmen
Pendant les deux mois qui suivent, mille sept cent soixante-douze enseignants ou personnels des lycées de Pékin sont torturés et assassinés par leurs élèves. La terreur s’étend ensuite à tout le pays : les jeunes Gardes rouges, chargés de lutter contre les Quatre Vieilleries (les vieilles idées, la vieille culture, les vieilles coutumes et les vieilles habitudes), détruisent tout ce qui est antérieur à 1949. Des millions de livres, d’œuvres d’art sont brûlés, des temples et des palais dévastés, et surtout des milliers de personnes torturées et assassinées. Le pays plonge rapidement dans la guerre civile : fervents de la Révolution culturelle contre opposants, mais aussi combats sanglants entre différentes factions de Gardes rouges. Aussi, en juillet 1968, Mao fait intervenir l’Armée populaire de Libération qui, vite fait bien fait, réduit à néant ces Gardes incontrôlables. Lesquels, à leur tour, vont connaître les laogai 劳改, les camps de « rééducation par le travail ».

Sur la peinture, Song Binbin pose de profil, en treillis militaire et casque sur la tête. À son biceps gauche un brassard rouge sur lequel est écrit en caractères dorés les mots Garde rouge, hóng wèi bīng 紅衛兵. Sur sa sacoche est inscrit Servir le peuple, Wéi rénmín fúwù 为人民服务. Sur sa poitrine, un badge affichant le profil de Mao Zedong. Sur son épaule droite, en bandoulière, un fusil-mitrailleur Type 56, copie chinoise de la Kalachnikov AK-47. Tourné vers nous, le visage de la Garde rouge ne ressemble pas vraiment à celui de Song Binbin, qui portait en toutes circonstances de grandes lunettes.

C’est pourtant ce visage, un peu arrondi, qui sera popularisé. Et pour affirmer qu’il s’agit bien, mais oui, de Song Binbin 宋彬彬 alias Song Yaowu 宋要武, sur le mur derrière elle est peint en grand le caractère Wu 武, le combat, partie du surnom que lui donna Mao.
Cette peinture n’est sûrement pas l’œuvre originale mais plutôt une copie imparfaite, comme ces trois autres, toutes probablement produites au cours des années 1990 ou au tout début des années 2000 au sein des ateliers de Dafen, dans la banlieue de Shenzhen (dont j’avais parlé, il y a bien des années, dans la Boîte à Images et ensuite chez Arrêt sur Images) :

Qui a peint l’œuvre originale ? Où, quand ? Où est-elle ? À toutes ces questions une seule réponse : mystère et boule de gomme. Quoi qu’il en soit, et malgré la condamnation tardive des Gardes rouges par Mao, Song Binbin alias Song Yaowu demeure une icône de la Chine contemporaine. Ainsi, dans les années 1980, un peintre célèbre nommé Liu Changwen 刘昌文 réalise une importante série de portraits hautement apologétiques, dont voici trois exemples :



Il en existe beaucoup plus du même artiste, en voici quelques-uns :

Plus tard, en 2006, le peintre Zhang Dazhong 張大中 peint à son tour une série de Gardes rouges un tantinet sexualisées.


Stop ou encore ?

Puis, en 2007, Tian Taiquan 田太权 réalise des photos-montages de Gardes rouges plus ou moins dénudées, à la mémoire des quatre cents Gardes morts entre 1967 et 1968 dans des combats entre factions rivales. Certaines de ces photos ont été réalisées dans le seul cimetière qui leur est dévolu, à Chongqing. Ces séries s’intitulent Perdues, Sacrifiées, Oubliées.



Allez, un peu de rab :

On peut se demander ce que signifient, à coups d’images exclusivement féminines, ces réhabilitations, ces héroïsations, ces sanctifications des Gardes rouges, assassins en série, devenus par la grâce de Photoshop des martyres sexualisées. Sans parler de ces portraits flatteurs, irréalistes, de Song Binbin alias Song Yaowu, telle une Vierge Marie rouge sang.
En janvier 2014, Song Binbin a présenté ses excuses pour tous les crimes commis par les Gardes rouges. « Je ne cesserai jamais de demander pardon à l’enseignante que nous avons tuée. » Cette contrition, souvent jugée insincère, a entraîné moult débats en Chine.
Song Binbin est morte d’un cancer à New York en 2024. Son portrait idéalisé, divinisé, sans cesse dupliqué, la mène toutefois vers une incompréhensible, une insupportable immortalité. Sans les lunettes.


























 Portrait d’un lettré confucéen coréen, peut-être Kang Yi-o, fin XVIIIe-début XIXe s.,
Portrait d’un lettré confucéen coréen, peut-être Kang Yi-o, fin XVIIIe-début XIXe s.,



























 Sceau sur poterie datant de l’époque
Sceau sur poterie datant de l’époque









































 Photo © Alain Korkos
Photo © Alain Korkos
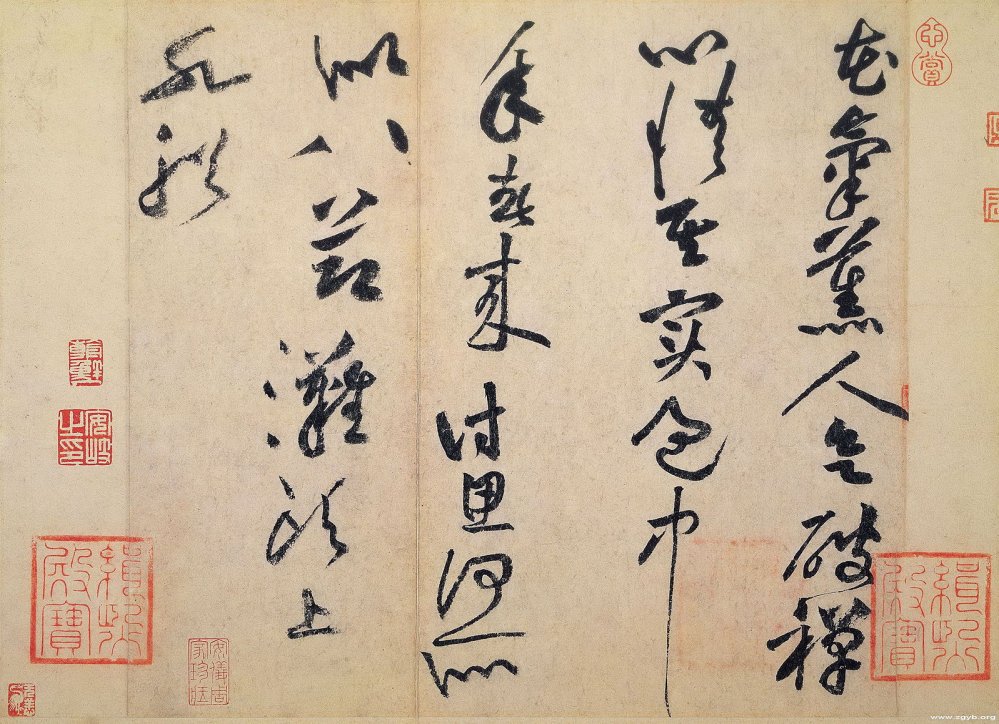
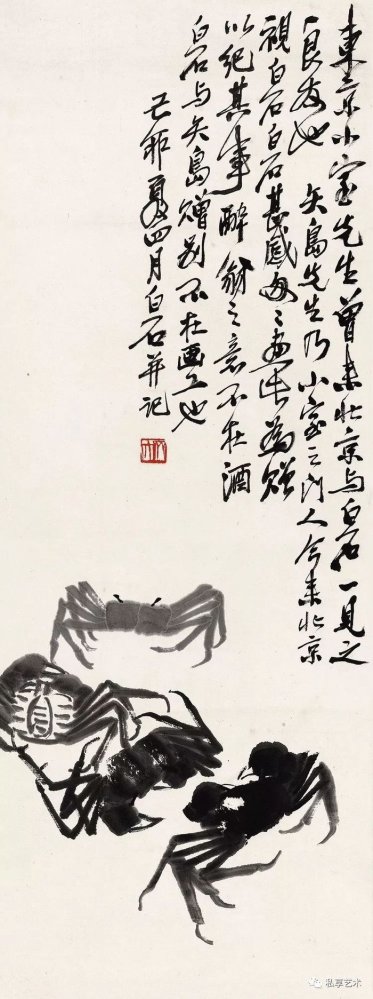
 Photo © Alain Korkos
Photo © Alain Korkos Photo © Alain Korkos
Photo © Alain Korkos Photo © Alain Korkos
Photo © Alain Korkos























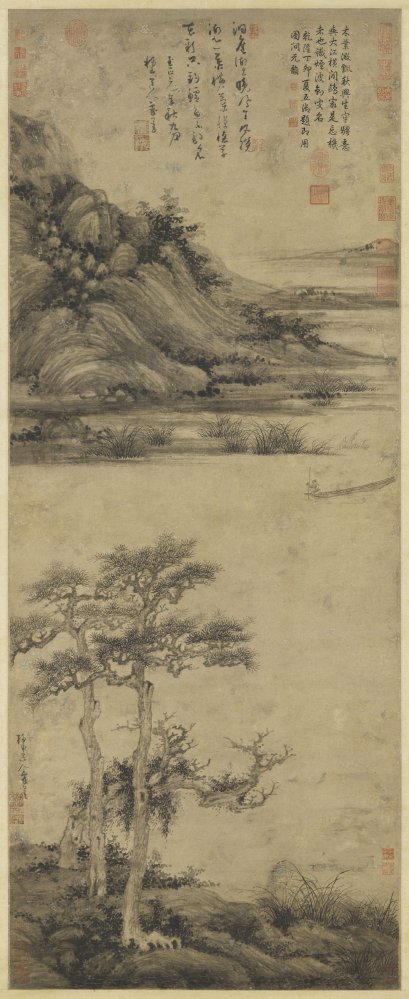







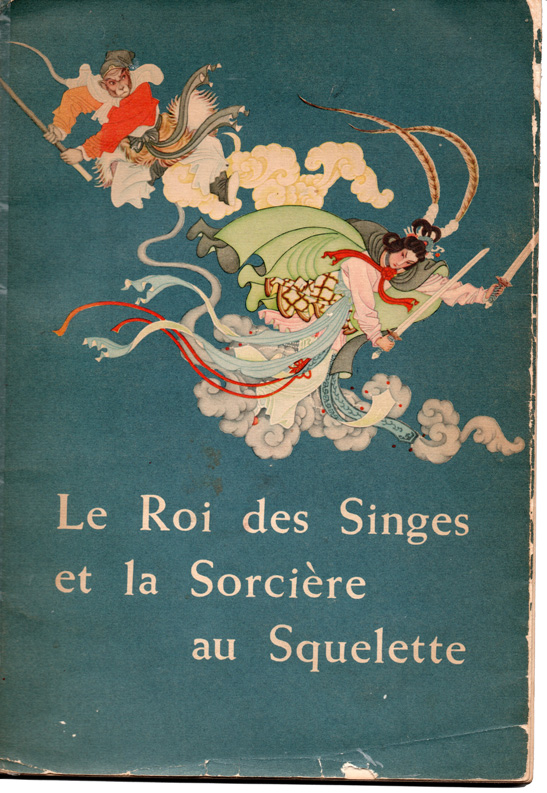
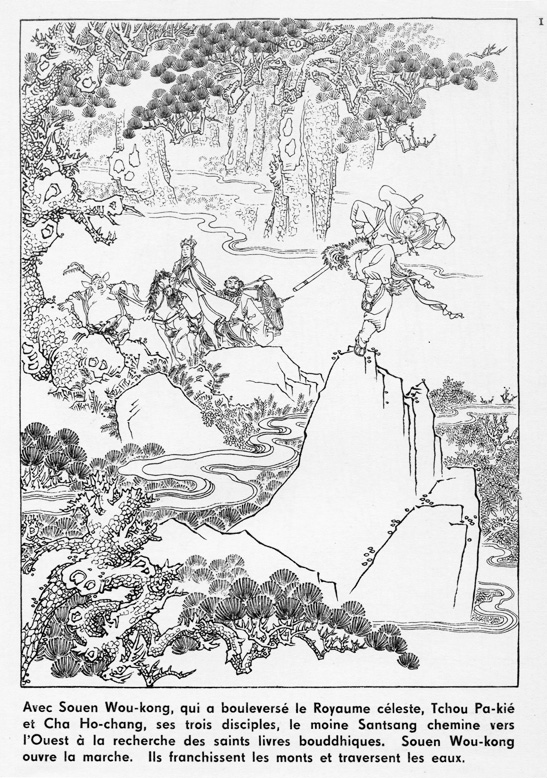
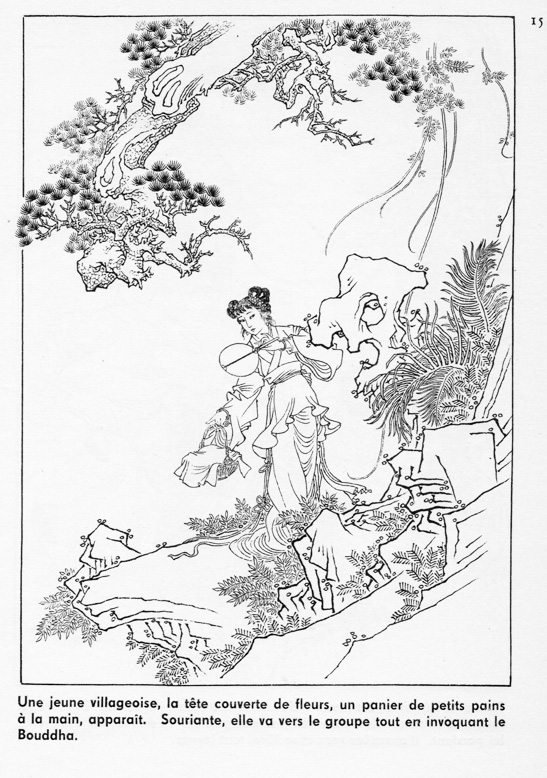
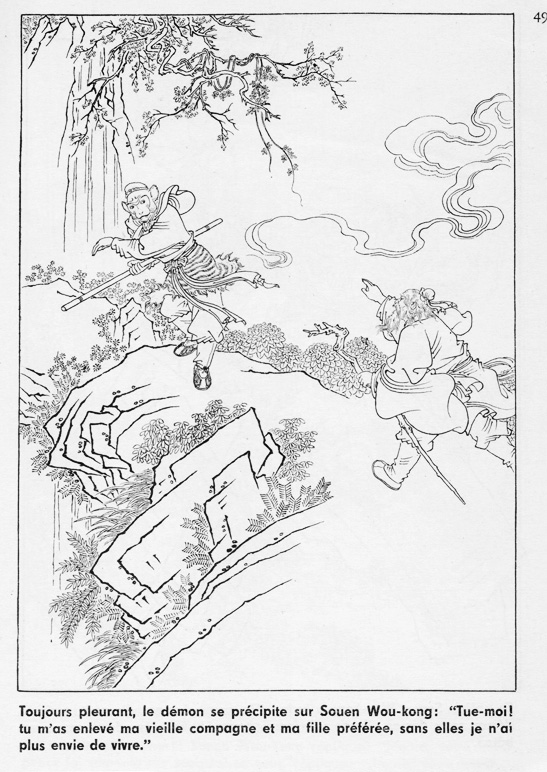
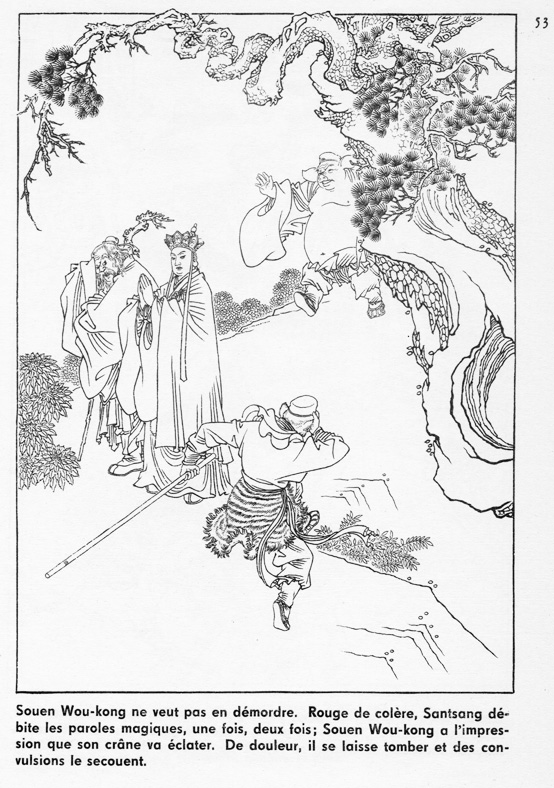
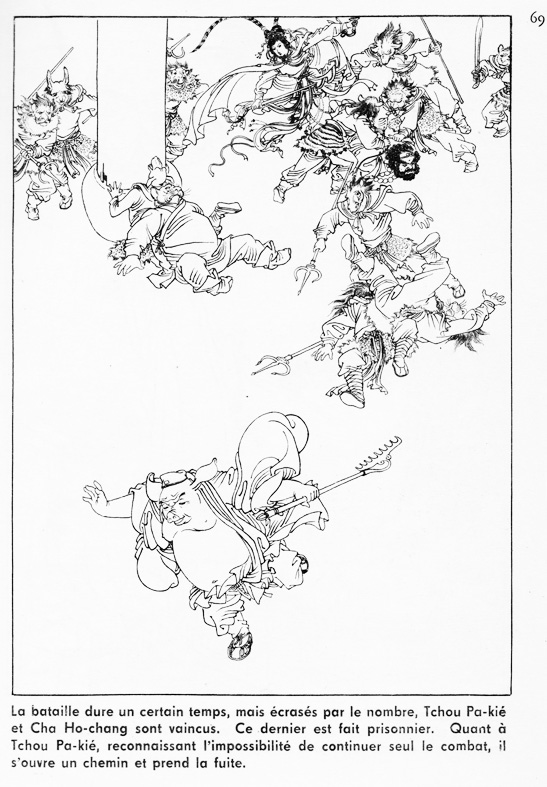
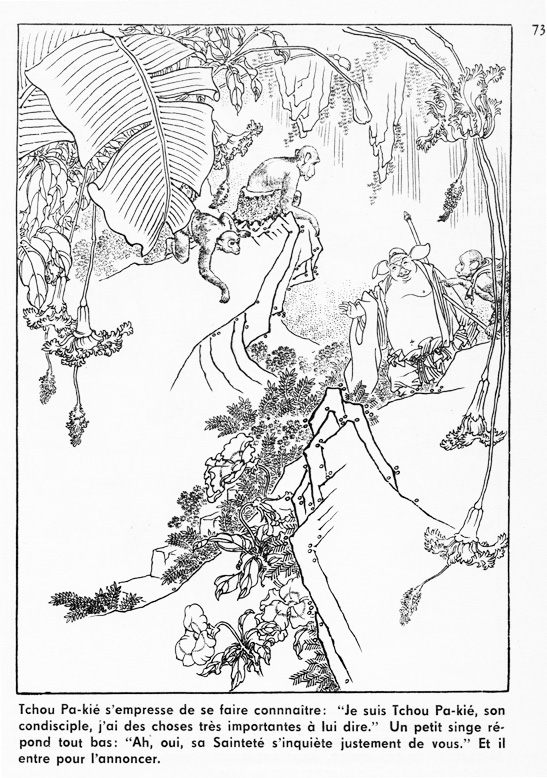
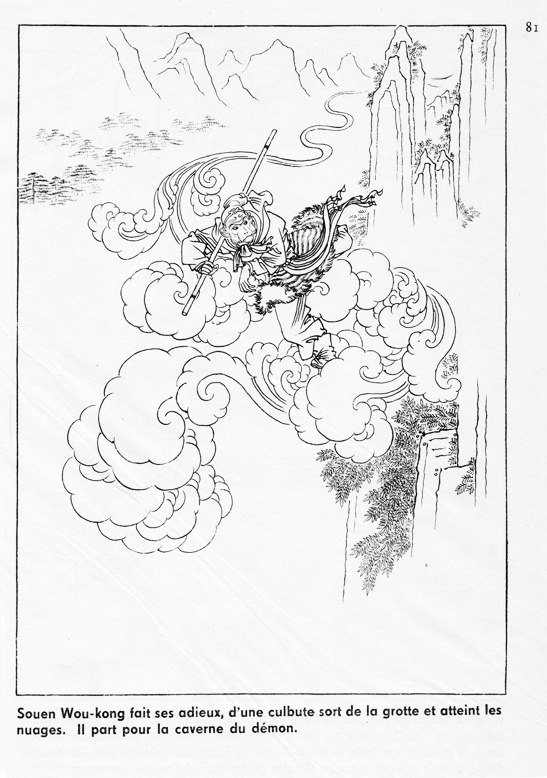
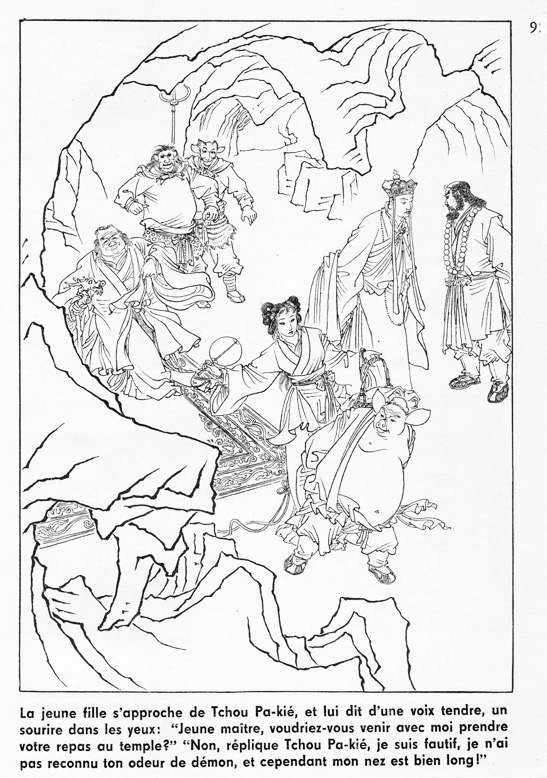
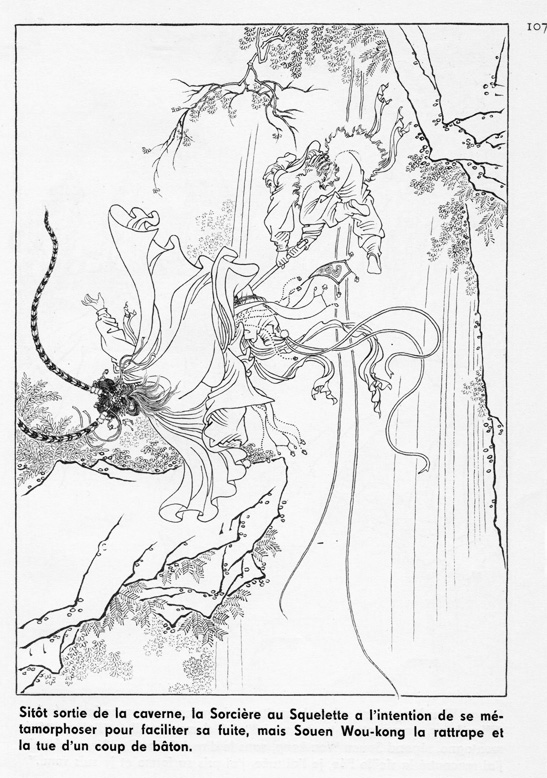










Derniers commentaires